|
|
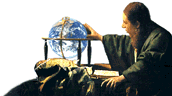 Noé , un
site pour les profs
Noé , un
site pour les profs |
Enseignement
à distance
et Débats
Archives 2002
|
Compte-rendu
du jeudi du Préau du 19/12/2002
" Présentation par Nuxeo de la plate-forme open source
ZOPE,
gestion de contenu et travail collaboratif" |
| |
Un compte-rendu plus complet sera mis en ligne sur le site du
PREAU qui organise ces
journées de présentation.
Eric Barroca et Arnaud Lefevre de Nuxeo
ont présenté leur société de service,
les problématiques posées par la gestion de contenu
web (rôle des auteurs, du webmaster, cohérence des
contenus, respect d'une charte graphique, validation éditoriale).
ZOPE est une plate-forme
de travail collaboratif (pas encore de e-learning) en
open-source. Un des concepts fondamentaux est la séparation
des données, des logiques et traitements (en Python) et
des présentations (XML/XSLT).
CPS, la technologie
Collaborative Portal Server, est une surcouche logicielle
à la plate-forme Zope. Elle permet facilement aux organisations
de gérer leurs contenus en s'appuyant sur une approche
web collaborative.
ZOPE est un concurrent de SPIP
. C'est encore loin d'être une plate-forme de type LCMS
(Learning Content Management System).
Quand on évoque la question d'un parcours individualisé
pour une formation, il a souvent un très grand quiproquo.
Les uns envisagent un découpage en modules de formation
qui s'assemblent en fonction d'un test de pré-requis, les
autres une navigation dans un parcours de formation en fonction
d'un jeu de droits et d'habilitations, et d'autres encore espèrent
un contenu qui s'adapte en permanence aux interactions de l'apprenant.
NOE oeuvre dans cette dernière perspective, tandis que
le produit présenté était plutôt de
l'ordre du deuxième.
|

Compte-rendu
de la journée d'étude du 12/11/2002
" Théories et pratiques de l 'enseignement à
distance"
|
| |
Le laboratoire Paragraphe et le département IPT de l'université
Paris VIII organisaient cette journée.
L'auditoire était nombreux, environ 250 personnes, et venait
d'horizons divers, principalement de l'enseignement supérieur
et de la formation continue.
Le matin était consacré aux campus numériques
et aux plates-formes d'enseignement à distance, l'après-midi
aux pratiques des Universités de Picardie, Nancy et Grenoble,
ainsi qu'à une réflexion sur les contenus en ligne.
Les textes présentés
par les conférenciers lors de cette journée.
Philippe Perrey de la Direction de la technologie a dressé
l'état des lieux des campus numériques.
COMPETICE
est un outil de pilotage par les compétences des projets
TICE dans l'enseignement supérieur
En 2002, le Ministère a financé en priorité
les projets émanant de consortium regroupant plusieurs
établissements
( 65 campus
numériques de FOAD (Formation ouverte et à distance)
et 4 campus de ENT (Environnement numérique de travail).
Les ENT semblent en progression (annuaire, sécurité,
personnalisation, nomadisme, services aux étudiants)
Le budget TICE par étudiant et par an est assez variable:
à l'Université, il est en moyenne de 20€ (
de 10 à 61 € selon les Universités). Il est
de 105€ en école d'ingénieur et de 28,5€
en IUFM .
L'activité d'enseignement en ligne est encore marginale:
en 2002, environ 1000 unités de cours sont accessibles
en ligne.
Et parmi les 1,4 millions d'étudiants, seulement 22000
sont concernés par ces enseignements.
Le Ministère prévoit 91000 étudiants pour
2002-2003, et 157000 l'année suivante.
Plusieurs plates-formes d'enseignement à distance ont été
présentées. Il est surprenant, à première
vue, que les 3/4 des plates-formes utilisées dans les campus
aient été développées en interne pas
les universités elles-mêmes.
INES, développée à l'Université
de Picardie par exemple, initialisée dès 1997
a évolué en collant aux besoins exprimés
par les étudiants (nécessité de la présence
de documents imprimables et d'annales).
Eric Ecoutin expert ès-plates-formes de EIFEL a confirmé
que la plate-forme idéale n'existait pas, en distinguant
4 champs fonctionnels plus ou moins couverts par les plates-formes
existantes. On trouvera un complément de présentation
sur le site d'ALGORA
ou sur le site THOT
qui recense 223 plates-formes
Quelques produits ont été présentés:
-HyWebMap
moteur de recherche
-K-web Organizer outil de supervision de travail collaboratif
-Gendoc éditeur
XML, ou GENDOC
Gérard-Michel COCHARD, professeur à l'Université
de Picardie, a présenté son expérience de
mise en oeuvre et de gestion d'une formation à distance
dans le cadre d'un troisième cycle en formation continue.
Marc Gabriel, François Bocquet ont fait de même en
ce qui concerne Nancy1
et Grenoble.
Ces orateurs ont évoqué leurs expériences
de plusieurs années.
Le travail de l'enseignant est plus dense que dans l'enseignement
traditionnel. L'enseignant était auteur compositeur interprète.
En formation à distance, il participe et contribue nécessairement
à une équipe. 11 fonctions de l'enseignant ont été
identifiées: concepteur, tuteur, animateur- coordinateur,
pédagogue, communicateur,...
La fonction de tuteur représente une activité importante
et une des difficultés principales pour l'enseignement
à distance. Elle représente 75% des coûts
du système. Le tuteur doit être un spécialiste
de la communication. La qualité des ressources pédagogiques
d'accompagnement du tuteur compte beaucoup.
La difficulté de la lecture d'un grand nombre de mail n'est
toujours pas résolue. En revanche, il semble que les aspects
juridiques (droits d'auteurs) et financiers (paiement des enseignants)
soient à peu près résolus.
Les étudiants à distance et les autres passent exactement
le même examen. Les premiers réussissent mieux de
manière évidente. Avant d'en tirer des conclusions,
il faut tenir compte qu'il s'agit d'un public de 3e cycle, extrêmement
motivé et exigeant (travailleurs en activité)
Les contenus en ligne doivent aussi tenir compte des cultures
des pays concernés: en ce qui concerne la transmission
de données fines sur l'activité de l'apprenant à
l'entreprise. Sur ce sujet précisément, ce qui est
permis aux USA ne l'est pas en Europe, et l'Allemagne est moins
permissive que la France.
Les normes pour l'enseignement à distance progressent.
L'étudiant , comme l'enseignant n'a pas à se former
au système. Mais les documents pédagogiques doivent
être structurés ( XML, distinction entre documents
et scénarios pédagogiques). Dans la plupart des
cas, un processus transforme ces contenus en modules pédagogiques
utilisables en ligne.
Les thèmes des débats étaient prévisibles.
Ne va-t-on pas industrialiser la formation au dépens de
la variété des approches et de la recherche elle-même?
où va se construire le savoir ? Quel statut pour l'enseignant
? Ne faut-il pas placer l'étudiant au centre du dispositif
? Nous avons eu droit évidemment à la dispute entre
les partisans de la notion d'"étudiant" associée
à une conception prescriptive de l'enseignement et celle
d'"apprenant" favorisant l'autonomie et la démarche
active de l'élève. Apprendre ou acquérir
?. Nous avons eu même un prophète du e-learing qui
a annoncé le e-learning de la 5ème dimension (mais
je n'ai pas tout compris).
L'état des lieux décrit ne semble pas encore à
la hauteur des enjeux identifiés, à savoir: la réaction
à la forte progression des propositions
de contenus anglo-saxons, les perspectives d'aménagement
du territoire, la modernisation de l'Université, l'amélioration
de l'accès au savoir.
Même s'il est indéniable que d'énormes efforts
sont en cours.
|

Débat
du salon de l'Education 20/11/2002
"Comment
le Service Public d'éducation doit-il accompagner l'évolution
des aides et des pratiques pédagogiques dans un contexte
de changement technologique?" |
| |
 F.Jarraud et A.Costes
F.Jarraud et A.Costes
|
François Jarraud ouvre le débat en
présentant le café pédagogique. Les autres
participants à la table ronde représentant l'institution,
François représentait les attentes des enseignants.
La pratique d'internet change la culture des enseignants. Les
enseignants sont sensibles au regard de leurs pairs. La culture
hiérarchique du monde de l'Education Nationale s'oppose
à la culture horizontale du net. Les enseignants demandent
à l'institution d'accompagner et de soutenir les actions.
Il faut accorder du temps au acteurs de terrain, et renforcer
la visibilité des actions entreprises. Il ne faut pas craindre
le foisonnement. Il faut au contraire soutenir la création,
et pas seulement les éditeurs reconnus.
L'attente vis à vis du Ministère est d'aider à
la promotion des actions de terrain, et d'accompagner le foisonnement.
Claude Mollard, directeur du SCEREN CNDP, évoque les écarts
entre le développement technologique actuel par exemple
la production de DVD et la réalité scolaire limitée
aux lecteurs de cassettes VHS. Le CNDP s'oriente toutefois vers
des bouquets de services IDS ( Imprimer, DVD, Sites ). Deux autres
problèmes sont soulevés: le décalage entre
les concepteurs de produits pédagogiques et les enseignants,
et celui de la libération des droits. Il annonce un partenariat
avec "La 5" pour un web-TV disponible dans les établissements
pour environ 400€ par an et par établissement. Il
s'agirait de produits audiovisuels numérisés en
téléchargement gratuit dans la classe pour des séquences
de 3 à 13 minutes.
Jean-Louis Billouet, directeur général adjoint
du CNED, a rappelé que les 70 000 élèves
du CNED n'ont pas tous un accès internet. De plus, ce n'est
pas parcequ'on se promène sur le net qu'on fait un acte
de formation. Le CNED insiste sur la nécessité d'un
processus d'industrialisation des contenus pédagogiques.
Enfin, il a posé une question récurrente, celle
de leur labélisation. Mais il s'agit d'une question ancienne
: les manuels scolaires réalisés dans le domaine
privé, sans label, expriment la diversité des approches
pédagogiques avec la seule contrainte des programmes.
Christophe Stener, Directeur des relations institutionnelles
de Microsoft Education. "relations institutionnelles",
ça doit se traduire par lobying en anglais. Nous avons
écouté le couplet citoyen de Microsoft sur l'accès
des handicapés à internet.
Alain Costes, directeur de la technologie au Ministère,
s'est déclaré "en harmonie avec François
Jarraud". La passion des enseignants a permis de réaliser
une première étape. Il faut passer à une
autre étape. Le Ministère a négocié
des accords sur les droits avec le Louvre, ARTE, l'INA, la BBC,
la BNF, et ainsi met gratuitement 600 heures d'utilisation de
produits gratuitement. Le défi d'aujourd'hui est d'initialiser
des projets à l'échelle européenne.
Jean-Paul de Gaudemar, directeur de la DESCO du Ministère,
a mentionné un plan de formation virtuel en relation avec
les Ecoles Normales Supérieures. Une première expérience
dans le domaine des sciences de la Terre avec l'ENS de Lyon est
un succès. Par ailleurs, il s'est principalement adresser
aux collectivités locales en rappelant l'importance de
leur rôle dans le financement des matériels en investissement
et en fonctionnement.
Corinne Hermant, de la direction générale Education
et culture de la Commission Européenne, a présenté
les quatre axes du plan e-learning de l'Europe: recherche et infrastructure,
formation des enseignants, services et contenus, coopération
et mise en réseau. Mais ce qu'il manque c'est une vision
des enjeux. Il faut une reconnaissance de la diversité
de l'Europe. Il existe un superbe projet d'éducation artistique
à Florence et un excellent travail de formation des enseignants
en Suède.
La salle a posé quelques questions et fait quelques remarques:
- il existe des enseignants qui n'ont pas le niveau du B2I
- que deviennent les expériences sur le cartable électronique?
- Comment reconnaître le caractère de "service
public" de certaines associations d'enseignants?
à suivre...
|

Table
ronde du salon de l'Education 20/11/2002
"Langues
: les échanges à distance, une nouvelle pratique
pour l'enseignement des langues" |
| |
Christine Reymond, rédactrice au
Café Pédagogique,
a animé cette table ronde. Les quatre intervenants ont
présenté tour à tour les différents
modes d'échanges de correspondances
dans le cadre de l'enseignement scolaire des langues.
 Christine Reymond et Philip
Benz
Christine Reymond et Philip
Benz
|
Christine Reymond a commencé par
décrire sa propre expérience d'utilisation du projet
e-tandem
au sein de l'académie de Rouen. L'enseignement est réalisé
dans une relation d'élève à élève
entre natifs. L'autonomie et la réciprocité sont
les deux principes de ce mode. Cinquante
langues sont disponibles. La difficulté du système
est de trouver pour chaque élève un partenaire fiable.
Philip Benz, professeur, responsable du
site Viv@.
Principalement pour pallier cette difficulté, Philip Benz,
en collaboration avec le CDDP de l'Ardèche, a conçu
un système de correspondance par forums
thématiques : le projet VIV@. Les correspondants ne sont
pas attitrés. L'absence de réponse d'un élève,
ou le départ en vacance d'une classe
entière ne perturbent pas le système. VIV@ a commencé
en 2000-2001 avec anglais-français. Il s'étend cette
année avec l'espagnol, l'allemand,
le portugais et l'espéranto.
 Jean-Richard Brousse et Maylis
Peuchaud
Jean-Richard Brousse et Maylis
Peuchaud
|
Jean Richard Brousse, professeur en troisième
à Agen, a présenté une correspondance classe
à classe avec un collège de Barcelone. Comme
les élèves débutent dans l'apprentissage
de la nouvelle langue, chaque élève travaille dans
sa propre langue. Les messages sont centralisés
sans censure. L'analyse de courriers se fait collectivement au
rétroprojecteur. Une rencontre réelle entre les
élèves a eu lieu à Carcassonne.
Les élèves ont cours le même jour, ce qui
accélère les échanges. Ces deux conditions
permettent un dynamisme des échanges et le
succès du projet.
Maylis Peuchaud, professeur dans un collège
près de Bordeaux, a utilisé le site epals
pour trouver les correspondants de ses élèves. L'échange
s'est fait en espagnol avec des élèves de Cancoun
au Mexique. La première phase était
la prise de conscience des préjugés de chacun, puis
la découverte de la culture de l'autre. Là aussi,
l'envoi de "véritables" cartes postales et
de petits cadeaux ont favorisé le dynamisme des échanges.
les principales questions des participants
ont porté sur la manière de traiter les erreurs
dans les messages envoyés par les élèves,
et sur la difficulté à
trouver des partenaires fiables. Il n'y a de correction souvent
que pour faciliter la compréhension. En ce qui concerne
les partenaires, les intervenants
ont tous insister sur la nécessité de lancer plusieurs
projets simultanément et d'attendre avant d'en parler aux
élèves. La relation entre
les deux enseignants est aussi une condition préalable
au succès du projet.
Enfin, plusieurs participants ont signalé
des initiatives diverses:
Primlangues,
un site d'accompagnement pédagogique du Ministère
pour l'enseignement des langues notamment pour le primaire.
Une bourse
d'échanges et de correspondances sur le site du CIEP
Centre International d'Etudes Pédagogiques
Un dossier
très complet, au format pdf, réalisé
par le CRDP de l'académie de Versailles, sur les expériences
réalisées d'échanges de correspondances.
Cyberlangues,
l'association des profs utilisant les TIC dans l'enseignement
des langues
Spring Day - Le
Printemps de l'Europe entend aider les établissements
à organiser un événement le 21 mars 2003,
à savoir leur propre Printemps
de l'Europe. Cet événement aura pour objectif d'impliquer
davantage les professeurs et leurs élèves dans la
définition d'une nouvelle Europe
au travers de la Convention européenne.
|

Débat
du salon de l'Education 20/11/2002
"Comment
faire évoluer les programmes face au défi de la
construction européenne et de la mondialisation" |
| |
Denis
Paget, secrétaire général du SNES
Jean-Didier Vincent, président du Conseil National des
Programmes
Dominique Raulin, secrétaire général du Conseil
national des Programmes
Christian Roger, directeur de l'agence Socrates France
 Denis Paget, secrétaire général
du SNES
Denis Paget, secrétaire général
du SNES
|
Denis Paget, secrétaire général
du SNES, ouvre le débat en souhaitant que s'il devait exister
un programme européen, il ne soit pas un leurre pour la
jeunesse. Il est préférable de présenter
la réalité de l'histoire de l'Europe faite plutôt
de différences. Il suggère que l'histoire soit présentée
à partir de problèmes à résoudre plutôt
que comme une hagiographie avec un patrimoine fictif. Les participants
dans la salle ont évoqué le décalage entre
les programmes et l'histoire contemporaine. Monsieur PAGET fait
remarquer qu'il sera toujours difficile d'enseigner l'ultra contemporain.
 Jean-Didier Vincent et Dominique
Raulin du CNP
Jean-Didier Vincent et Dominique
Raulin du CNP |
Jean-Didier Vincent, président du
Conseil National des Programmes
Les programmes ont en France une place qu'on ne retrouve pas dans
les pays anglo-saxons ou d'Europe du Nord.
Jean-Didier Vincent a été ensuite manifestement
provocateur en affirmant la nécessité d'un programme
socle pour l'Europe, et en essayant de montrer que ce socle devait
être caricatural pour être efficace.Le programme est
un instrument de cohésion sociale. L'empire européen,
démocratique, peut être obtenu par les programmes
scolaires. L'élaboration d'un fond commun dans le domaine
de la recherche est un résultat déjà acquis
au niveau européen. L'école est le lieu d'élaboration
des mythes fondateurs. Mais attention , les mythes fondateurs
sont des mythes d'exclusion. L'Europe des tolérances, ça
fait partie des mythes fondateurs.
Dominique Raulin, secrétaire général
du Conseil national des Programmes
La culture européenne n'est pas à inventer, elle
existe.

Christian Roger, directeur de l'agence Socrates
France
|
Christian Roger, directeur de l'agence
Socrates France, a étendu la question du socle des savoirs
à celui des comportements. Apprendre à travailler
ensemble est déjà l'objet de plusieurs programmes
européens. Plusieurs programmes européens ont ensuite
été évoqués:
Le "processus
de Bruges" pour la coopération en matière
de transparence, de reconnaissance et de qualité des formations
en Europe.
Le
programme pour le suivi des objectifs des systèmes d'éducation
en Europe
Le programme
Socrates pour promouvoir une Europe de la connaissance et
encourager une éducation tout au long de la vie à
travers l'apprentissage des langues étrangères,
l'encouragement à la mobilité, la promotion de la
coopération au niveau européen, l'ouverture aux
moyens d'accès à l'éducation et une utilisation
accrue des nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation
coopération politique entre états favorisant la
mobilité
Les objectifs
des futurs systèmes futurs d'éducation
Les participants
dans la salle sont intervenus pour illustrer la situations des
programmes en Europe et aux USA.
Il y a des pays sans programmes. Les différences entre
les programmes ne portent pas que sur les lettres ou l'histoire.
Dans plusieurs pays d'Europe, on n'enseigne pas le théorème
de Thalès..... et on y survit.
Il a existé en France une proposition de loi pour faire
voter les programmes à l'Assemblée Nationale. Un
programme est politique. Retirer Pierre Bourdieu de la liste des
auteurs du programme des classes économiques et sociales
est politique. Dans les pays anglo-saxons, on a renoncé
à définir un socle. Aux USA, l'équivalent
du programme de mathématiques tient en 30 pages. Ce sont
les "standards", les attitudes intellectuelles de base.
Au terme du débat, un sentiment
général de malaise était peut-être
lié au fait d'avoir seulement effleurer un sujet trop vaste.
|

Débat
du salon de l'Education 22/11/2002
"La
technologie au collège, où en sommes-nous?" |
| |
C'est probablement cette table ronde qui a eu le plus de succès.
Le mal vivre exprimé par les enseignants de techno en est
sûrement la raison.
La table ronde était animée par Alexis Kaufmann
du café pédagogique
Yves Lemal, prof de techno et représentant de l'association
AEAT, dresse pour commencer
un historique de la discipline.
Claude Taddei, prof de techno et représentant de l'association
ASSETEC, présente
les difficultés que rencontre la discipline.
Jacques Ginestié, professeur à l'IUFM d'Aix-Marseille
et représentant l'association AEET,
replace l'enseignement de la techno dans le contexte européen.
Patrick Richard, prof de techno et représentant de l'association
PAGESTEC, a rappelé
le besoin des enseignants pour un échange sur les pratiques
de terrain.
 Claude Taddei (ASSETEC) et
Alexis Kaufmann (Café Pédagogique)
Claude Taddei (ASSETEC) et
Alexis Kaufmann (Café Pédagogique)
|
La technologie est une discipline jeune.
A peine majeure, instaurée il y a 18 ans, elle souffre
encore de nombreux maux.
Le sentiment général est que l'Institution ne reconnaît
pas vraiment la discipline et ses enseignants
Les programmes changent souvent, en terme de rupture (ex abandon
des scénarii). Les raisons des changements ne sont pas
claires. En biologie, il y a aussi beaucoup de changement mais
l'évolution pour s'adapter aux nouvelles découvertes
s'impose d'elle-même. C'est la seule discipline sans agrégation
ni inspection générale. Curieusement, ce n'est pas
perçue comme une chance, mais comme une hésitation
à la faire rentrer dans le paradigme des autres disciplines.
Il n'y a pas de cohérence nationale : les pratiques sont
très différentes d'un établissement à
l'autre. Le passage des cycles primaire, collège et lycée,
ne se fait pas en continuité. Enfin, les enseignants éprouvent
un besoin de stabilité qui se traduit parfois par une démobilisation,
et aussi par une difficulté de recrutement.
 Yves Lemal (AEAT) et Patrick
Richard (PAGESTEC)
Yves Lemal (AEAT) et Patrick
Richard (PAGESTEC)
|
Mais quels sont les véritables objectifs de l'enseignement
de la technologie?
Trois orientations se superposent, ce qui ne contribue pas à
la clarté. la nature d'un premier objectif est celle d'une
culture générale pour tous préparant l'éducation
technique des futurs techniciens et ingénieurs. Un autre
objectif évoqué par Luc Ferry est la prise en compte
de "l'intelligence pratique" des élèves
en difficulté. Un troisième objectif est la culture
spécifique à une orientation métier. Ceci
amène des contradictions, notamment quand il s'agit de
définir des objectifs en terme de compétences à
acquérir. Un travail peut être réalisé
comme dans d'autres disciplines pour définir des grilles
de compétences qui serviront ensuite à élaborer
un système d'évaluation. les activités technologiques
peuvent avoir un sens en elle-même comme dans un projet
partant de la conception jusqu'à la réalisation
d'un produit. Ce sens peut venir aussi d'un ensemble de compétences
clairement identifiées. Le risque actuel est d'absorber
les demandes du moment comme la préparation au B2I. Attention
à ne pas se limiter à ce travail, l'éventualité
d'une fusion sciences physiques et technologie n'est pas exclue.
 Jacques Ginestié (AEET)
Jacques Ginestié (AEET)
|
En France, comme en Europe, il est de plus en plus difficile
de recruter des ingénieurs et des techniciens.
Le déficit de recrutement des techniciens et scientifiques
s'observe dans toute l'Europe. Il a été abordé
dès 1982 dans une conférence de l'UNESCO. Mais depuis,
malgré des initiatives en France et en Grande-Bretagne,
la situation a empiré. En Grande-Bretagne, le nom de la
techno est "design & technology education". Ce qui
traduit une vision économique et sociale du monde technique:
la fabrication étant délocalisée, l'accent
est mis sur la conception des produits plus que sur leur fabrication.
Cette vision, ou une autre, manque en France.
La nécessité d'organiser la discipline et
de renforcer la représentativité des associations
fut la principale conclusion de la table ronde.
Dans d'autres
disciplines les associations influentes regroupent jusqu'à
85% des enseignants. En technologie, les trois associations rassemblent
moins de 15% des 18 000 enseignants de technologie.
|

Débat
du salon de l'Education 22/11/2002
"Comment
faire face au développement de la concurrence scolaire
au sein du service public d'éducation (compétition
entre établissements, cours privés...) et au développement
du marché de l'angoisse scolaire ?" |
| |
 Philippe Coléon (Acadomia)
Philippe Coléon (Acadomia)
|
Philippe Coléon, directeur
général de Acadomia,
présente sa société.
15000 enseignants travaillent pour Acadomia. Le marché
du soutien scolaire serait d'environ 1600 millions d'euros par
an. Le chiffre d'affaires des sociétés
du secteur est d'environ 240 millions d'euros par an, dont 80
pour Acadomia, auxquels s'ajoutent 80 millions d'euros
par an réalisés les associations. Le marché
déclaré (société+associations) correspond
à environ 20% de la demande. 80% du
soutien scolaire reste dans le domaine de l'économie parallèle.
Monsieur Coléon suggère de normaliser le métier
du soutien scolaire.
Y-a-t-il véritablement augmentation de l'angoisse scolaire?
Les structures familiales ont évolué. Le travail
des mères et l'augmentation
des foyers monoparentaux génèrent un besoin d'assistance.
L'angoisse n'est pas seule en cause. Un tiers des élèves
a pris un cours dans le cadre du
soutien scolaire. il se vend chaque année 12 millions de
cahiers de vacance.
A une question de la salle à
propos des familles clientes de Acadomia, Monsieur Coléon
répond que les CSP+ ( catégorie socioprofessionnelle
supérieure) sont minoritaires. Il s'agit en majorité
de parents ayant des difficultés à aider leurs enfants.
Ces familles placent l'éducation
dans leurs priorités et y consacrent un budget annuel de
300 euros. Ce point est en contradiction un document
d'Acadomia "pouvoir d’achat élevé
des familles concernées par le service ACADOMIA (revenus
nets > 15.000 F par mois)"
( prospectus
pour l'inscription au marché libre de la bourse de Paris,
avril 2000, §4.6.2 page 58)
 Faride Hamada (FCPE)
Faride Hamada (FCPE) |
Faride Hamida, FCPE
C'est vrai qu'il existe des lacunes dans le système. C'est
l'école qui doit être son propre recours.
Monsieur Hamida expose son opposition au "système
marchand".
 Christian Janet (PEEP)
Christian Janet (PEEP)
|
Christian Janet, PEEP
Il faut que l'école continue à évoluer. L'existence
du privé et du parascolaire doit servir d'aiguillon à
l'Education Nationale.
 Serge Candor (CNED)
Serge Candor (CNED)
|
Serge Candor, CNED.
Pour les élèves d'âge scolaire, les activités
du CNED se répartissent pour moitié dans des parcours
complets ( 60000 inscrits, élèves
à l'étranger, itinérants), et moitié
dans le cadre des cours d'été et du soutien scolaire.
Le CNED reçoit chaque année une subvention
qui représente 25% de son budget. Le CNED envisage une nouvelle
politique tarifaire qui amènerait la gratuité pour
les cours relevant de l'obligation
scolaire. La remédiation n'est pas facile à organiser
au sein de l'éducation nationale, l'appel au privé
est une solution. La France est le
seul pays d'Europe, où l'éducation est une affaire
d'Etat.
 Philippe Tournier (SNPDEN)
Philippe Tournier (SNPDEN)
|
Philippe Tournier, secrétaire
général adjoint du SNPDEN
L'institution est complaisante. Les enseignants sont eux-mêmes
champions du consumérisme scolaire, des détournements
de la carte scolaire et du repérage
des classes"CAMIF". Ceci évolue un peu. D'autre
part, l'angoisse scolaire est une angoisse solvable. C'est
l'expression scolaire d'une angoisse sociale. Quand il y a concurrence
entre établissements, ce n'est pas, comme on le dit, les
parents qui choisissent l'école,
mais l'école qui choisit ses élèves.
 Jacques Simon (Education
Nationale)
Jacques Simon (Education
Nationale) |
Jacky Simon, médiateur
de l'Education Nationale
Le consumérisme scolaire présente un aspect positif:
il est le signe de familles qui s'intéressent à
leur enfant.
L'école ne peut pas tout faire, mais elle doit faire ce
que l'on attend d'elle. Les usagers citoyens veulent comprendre
ce qui se passe.
L'enquête
PISA de l'OCDE, évalue les compétences des jeunes
de 15 ans, ainsi que le coût des systèmes éducatifs.
Un
rapport belge sur l'étude PISA présente quelques
résultats. En France, pour 100 euros dépensés
en éducation, l'Etat en dépense 65, les collectivités
locales 20, et les familles entre 5 et 7 euros.
Les participants dans la salle ont évoqué
les différents dispositifs élaborés avec
le soutien des collectivités locales : clubs, études
du soir, contrat éducatif
local...Le constat, justement, c'est qu'il existe beaucoup de
différence selon les lieux.
Une participante signale qu'Acadomia bien que cotée en
bourse propose des contrats de CDD à l'heure, rémunérés
de 10,7 à 13,75 euros pour
un enseignement dans le primaire.
Le service public d'éducation n'est pas égalitaire
: il favorise ceux qui suivent un cursus long. C'est une discrimination
sociologique par le succès.
De fait, la gratuité est une redistribution en faveur des
classes moyennes et supérieures.
Aux Etats-Unis, le service public d'éducation est plus
sectorisé qu'en France.
Le débat
a été assez animé. La question centrale fut
de déterminer la limite d'une zone où pourrait s'exercer
le secteur concurrentiel et ce qui
ne doit pas l'être. Ce qui est obligatoire doit être
pris en charge par le service public. S'il existe des lacunes,
ou des difficultés, il faut
améliorer le système. Attention, les élèves
en difficulté, vraiment en difficulté, ne sont souvent
pas solvables.
|

|